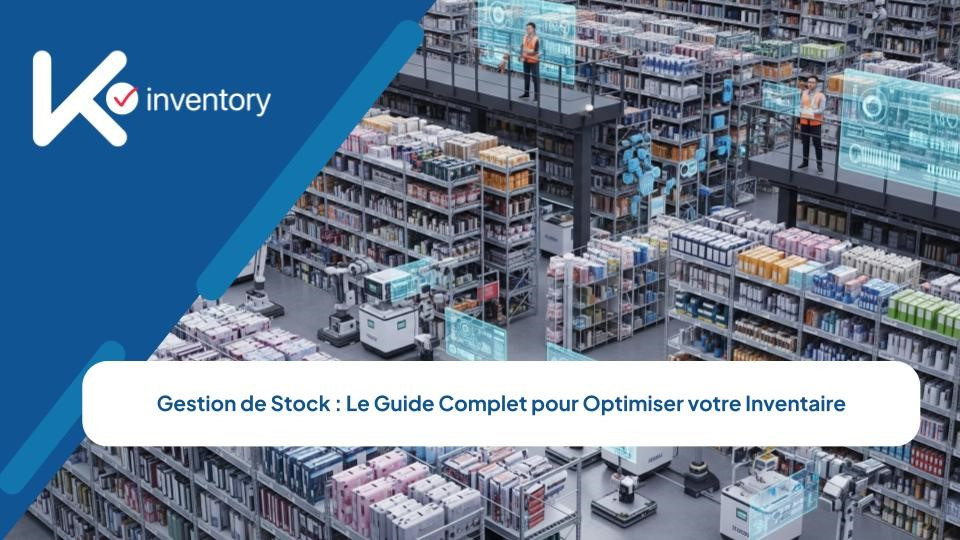Loi AGEC : Révolutionner la gestion du matériel dans les collectivités grâce à la technologie

Loi AGEC : Révolutionner la gestion du matériel dans les collectivités grâce à la technologie
La loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC), adoptée en France en 2020, marque une étape décisive vers une économie moins dépendante de la production de déchets et plus respectueuse de nos ressources. Avec un volume annuel de déchets ménagers et assimilés (DMA) estimé entre 35 et 40 millions de tonnes en France, dont environ 10% proviendraient des services publics, l'urgence d'agir est palpable. Pour les collectivités territoriales, la loi AGEC n'est pas seulement un cadre réglementaire ; c'est un appel à transformer en profondeur la gestion de leur matériel et de leurs actifs.
Le webinaire "Loi AGEC : quelles démarches pour une gestion plus durable du matériel des collectivités ?" organisé par K inventory le 29 avril 2025 a offert un éclairage précieux sur les défis et les opportunités liés à cette loi.
Loi AGEC : Un nouveau paradigme pour les collectivités
Promulguée pour réduire le gaspillage et favoriser l'économie circulaire, la loi AGEC vise à allonger la durée de vie des produits, améliorer le recyclage et limiter drastiquement les déchets. Elle s'adresse directement aux entreprises, producteurs et gestionnaires d'actifs physiques, y compris les collectivités. Ces dernières doivent intégrer plus de 50 mesures réglementaires d'ici 2025, impactant des domaines clés:
- La commande publique : L'article 58 impose, depuis mars 2021, d'intégrer dans les achats publics une part minimale (entre 20% et 40%) de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou contenant des matières recyclées. Cela représente un levier majeur, considérant que la commande publique pèse environ 160 milliards d'euros.
- La gestion des déchets : La loi renforce le principe de Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Ce dispositif, datant des années 90, fait supporter aux producteurs le coût de la gestion des déchets issus de leurs produits via des éco-contributions versées à des éco-organismes. La loi AGEC étend les filières REP et renforce les obligations des éco-organismes (transparence, audits, soutien aux collectivités). Le tri à la source (notamment des biodéchets) est également renforcé.
- La lutte contre le gaspillage et l'obsolescence : Des mesures visent à sortir du plastique jetable, à mieux informer le consommateur, à lutter contre l'obsolescence programmée (via la réparabilité) et à encourager le réemploi et la réparation.
Les défis spécifiques rencontrés par les collectivités
Si les objectifs sont clairs, leur mise en œuvre sur le terrain soulève des difficultés notables pour les acteurs publics :
- Modernisation et financement : La mise aux normes des infrastructures, comme les déchetteries, représente un coût élevé (estimé entre 200 000 et 600 000 € par projet), alors que les soutiens financiers des éco-organismes ne couvrent souvent qu'une fraction (20 à 40%) de ces frais. Ce manque de moyens peut freiner l'adaptation aux nouvelles filières REP.
- Coordination logistique : La complexité des procédures, le manque de visibilité sur les stocks et les équipements disponibles, ainsi que les erreurs de tri (qui peuvent concerner une part importante des déchets, notamment les DEEE ) compliquent la chaîne logistique. Cela peut entraîner des collectes inefficaces, des coûts supplémentaires, voire des dépôts sauvages.
- Traçabilité et reporting : L'absence fréquente d'outils numériques adaptés et interopérables rend difficile le suivi précis des flux de matériel, la coordination avec les éco-organismes et le reporting exigé par la loi (notamment sur les achatsxtydurables). Le manque de données fiables et de nomenclatures harmonisées est un obstacle majeur.
La technologie comme catalyseur de la transition
Face à ces obstacles, le webinaire a démontré que les solutions technologiques sont des alliées indispensables. L'approche K inventory s'articule autour de trois piliers technologiques complémentaires:
- L'automatisation des inventaires : En équipant chaque bien (mobilier, équipement urbain, matériel informatique) d'un identifiant unique (QR code, puce RFID) dès son entrée dans le patrimoine, on crée une base de données dynamique. Le scan mobile par les agents permet des mises à jour en temps réel, éliminant les inventaires manuels fastidieux et sources d'erreurs. Cette base contient des informations clés : dimensions, poids, matériaux, date de mise en service, potentiel de réparabilité, etc..
- L'exploitation intelligente des données : Les données collectées alimentent des tableaux de bord qui offrent une vision claire et en temps réel de l'état du parc : localisation des équipements, taux d'utilisation, état d'usure, cycle de vie. Cette visibilité permet d'identifier les stocks dormants, les besoins de maintenance préventive et les opportunités de réaffectation.
- L'IA pour l'optimisation prédictive : En analysant les historiques d'utilisation, les cycles de vie et les besoins exprimés, l'Intelligence Artificielle peut anticiper les demandes futures. Elle propose des redéploiements internes pertinents avant d'envisager de nouveaux achats, optimise les flux logistiques (groupement des collectes ), et aide à planifier les remplacements ou les réparations. Elle peut aussi faciliter la conformité en générant automatiquement les bordereaux pour les éco-organismes selon leurs nomenclatures spécifiques.
Les cas pratiques présentés lors du webinaire illustrent bien ces apports : gestion optimisée du mobilier en fin de vie interagissant avec Éco-mobilier, suivi et redéploiement intelligent du mobilier urbain, ou encore anticipation des besoins en fournitures pour un Conseil Départemental.
Des bénéfices tangibles pour les collectivités et l'environnement
L'implémentation d'une gestion d'actifs automatisée et intelligente se traduit par des avantages concrets et mesurables :
- Fluidité administrative et conformité : La génération automatique de rapports et bordereaux conformes réduit drastiquement le temps de préparation (divisé par 6 dans un cas pratique ) et assure le respect des obligations légales. Les interactions avec les éco-organismes sont simplifiées.
- Optimisation budgétaire : En priorisant le réemploi interne, en évitant les achats superflus, en réduisant les coûts de stockage temporaire et en optimisant les collectes, les collectivités réalisent des économies substantielles (jusqu'à 25% sur le budget mobilier annuel dans un exemple ).
- Gestion opérationnelle améliorée : Une meilleure visibilité sur le parc permet une planification proactive, une maintenance préventive efficace et une allocation optimale des ressources.
- Durabilité accrue : La prolongation de la durée de vie des équipements grâce au réemploi et à la réparation, ainsi que l'optimisation du tri et du recyclage, contribuent directement à réduire l'empreinte environnementale de la collectivité.
Conclusion : Piloter mieux pour moins gaspiller
En conclusion, la loi AGEC invite les collectivités à ne plus considérer leurs stocks et inventaires comme une simple charge administrative, mais comme des leviers stratégiques de durabilité, d'économie et de performance. L'inventaire dynamique et automatisé, couplé à l'exploitation fine des données et à l'intelligence prédictive, devient l'outil central pour relever ce défi.
Adopter une approche technologique pour la gestion des actifs n'est plus une option, mais une nécessité pour "piloter mieux pour moins gaspiller", répondre efficacement aux exigences réglementaires, maîtriser les coûts publics et renforcer la transparence et la valorisation des politiques locales en faveur de l'économie circulaire.
Pour en savoir plus sur K inventory, solution adaptée aux besoins des collectivités et référencée par l'UGAP, vous pouvez consulter les ressources de K inventory.